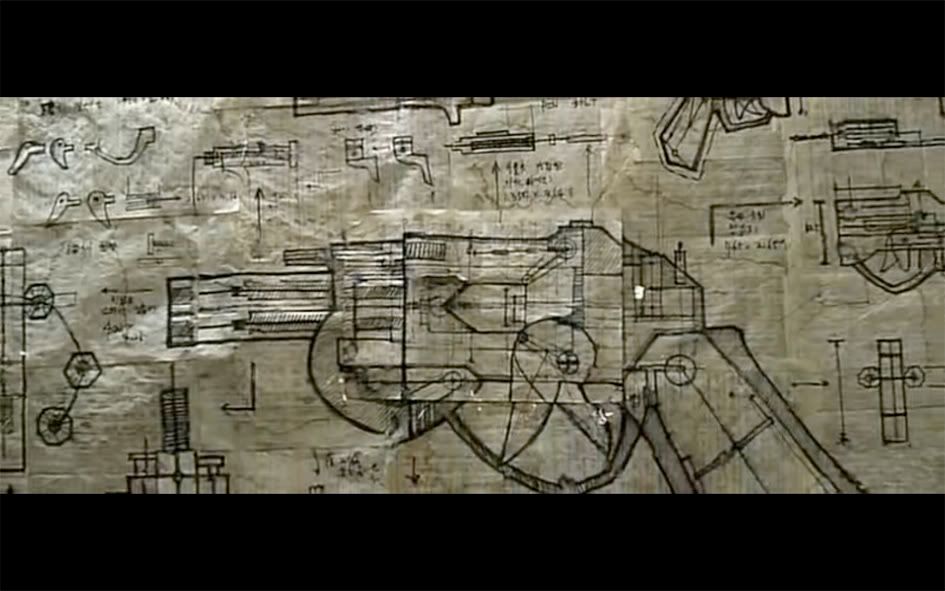Lady Vengeance, dégoût et des couleurs
Lady Vengeance, troisième opus de la trilogie sur la
vengeance, se révèle à chaque lecture d’une profusion et d’une jouissance dans
la mise en scène incroyable. Le film conclut ce violent cycle, après Sympathy
for Mr. Vengeance et Old Boy,
en condensant et dépassant ce que Park Chan-wook avait pu mettre en place dans
les deux précédentes histoires.
D’entrée
de jeu, le ton est installé sans fioriture. Passé un joli générique mêlant
sinuosités du corps, de plantes vénéneuses et l’onctuosité d’une pâtisserie, le
tout nappé d’une couleur rouge sans équivoque véritable, le film débute sur la
sortie de prison de Lee Geum-ja, l’héroïne (interprétée par Lee Yeong-ae, déjà
présente dans Joint Security Area).
Un groupe de choristes en habits de Noël l’attend patiemment, parlant d’elle
comme de la « détenue au grand cœur ». Le chœur entame une chanson
heureuse tandis que Lee Geum-ja s’avance déterminée, regard caméra, vers le
groupe. Le chef de la chorale se détache des autres pour offrir un gâteau au
tofu, signe de pureté, le regard visiblement plein d’espoir et d’émotion, qu’un
flashback et une voix off nous confirment. On y aperçoit quelques bribes du
passé, la transformation de cette jeune femme à la fois fragile et ravageuse.
Le retour à la scène initiale rompt ce climat presque joyeux. Lee Geum-ja fait
tomber volontairement le gâteau par terre et poursuit sa route sous les regards
horrifiés de la chorale tandis qu’elle lance un serein et narquois « Allez
tous vous faire voir ».
Cette
première scène détonante contient tous les éléments du film, comme un puzzle
que la narration va venir remettre dans l’ordre. L’humour, la violence,
l’onirisme et un certain encadrement social sont d’emblée présents. Qui est vraiment Lee Geum-ja ? Que
cherche-t-elle ? Ce n’est qu’au terme du long métrage que la réponse
deviendra claire, tandis que le portrait tortueux de la jeune femme se dessine,
entouré d’une galerie de personnages bien prononcés. Comme toujours chez Park
Chan-wook, la dimension politico-sociale vient uniquement servir l’histoire,
jamais l’inverse. On trouvera donc bien certains éléments comme la prison, la
pédophilie, la lutte des classes, la place de la femme dans la société qui
participent d’une radiographie de la Corée du Sud, mais cela n’est jamais le
but premier. Pour Park, il s’agit d’abord d’inspecter la genèse d’une
vengeance, les hésitations, l’expiation autant que la construction machiavélique
d’un plan.
La
structure en puzzle, amplifiée par la multiplication des points de vue et des
récits, sert à donner un rythme à la narration. Ce procédé de construction en
puzzle avait déjà été employé depuis Joint
Security Area (où la jeune militaire interrogeait diverses personnes pour
tenter d’élucider le mystère autour d’une fusillade) ou même dans Old Boy. Ce plaisir du puzzle donne des
moyens assez grands en termes de scénario, mais aussi permet d’associer le
spectateur à l’enquête. La figure même du puzzle apparaît dans le film, lorsque
Lee Geum-ja rassemble les morceaux d’un schéma devant servir à construire un
revolver particulier. Là où le puzzle servait l’affaire, il ne compte dans Lady Vengeance que pour dresser le
portrait de la jeune femme et de son plan, davantage que pour cerner le
véritable méchant de l’histoire. En cela, Park Chan-wook évolue dans la
construction de ses récits.
La
femme est centrale dans le cinéma de Park Chan-wook, notamment dans Lady Vengeance. Tour à tour manipulatrice,
victime, rédemptrice ou simple observatrice, elle ne cesse d’accompagner le
récit. L’incursion dans le milieu carcéral avec sa galerie de détenues permet à
Park Chan-wook de diffuser progressivement les facettes de Lee Geum-ja. Les
retournements dans la psyché du personnage sont fascinants, puisqu’il dévoile
la tension qui naît dans l’esprit de la jeune vengeresse, désireuse autant de
corriger son passé que de construire son avenir. La femme est souvent affiliée à la question
de la maternité ou de l’enfant dans l’œuvre de Park Chan-wook. Dans Lady
Vengeance, les deux aspects se retrouvent puisque la jeune femme récupère sa
fille, doit affronter le deuil des autres parents et ne trouve un salut que
dans l’amour maternel qu’elle développe.
Le développement
de Lee Geum-ja évoque une autre dimension thématique du cinéma de Park
Chan-wook. La mutation des êtres est souvent au cœur de ses films. Dans Old
Boy, un violent choc transforme peu à peu le protagoniste, tout comme dans
Thirst, la maladie vampirique change à jamais les deux héros et bouleverse
l’environnement des autres personnages. Dans Lady Vengeance, le choc initial
tient de l’arrestation de Lee Geum-ja et des horribles évènements qui y sont
affiliés. L’héroïne devient un être en apparence froid, jouant des illusions
jusqu’au nouveau choc des retrouvailles avec sa propre fille qui transforme à
nouveau la femme en lui redonnant une humanité. Il s’agit à chaque fois de
réconcilier le trauma et les évènements extérieurs, selon chaque film la résolution
se solde par un échec tragique ou par une rédemption.
La
violence des intérêts personnels entraîne souvent des chocs impressionnants
dans le cinéma de Park Chan-wook. Dans Lady
Vengeance, la violence est multiple, à la fois sournoise et brutale, mais
un constat d’échec se laisse entrevoir lorsque la vengeance et la violence
paraissent incapables de résoudre le
vide de l’absence ou de remplacer la
justice. A travers sa trilogie, Park Chan-wook aura exploré diverses phases de la vengeance, de la pulsion vengeresse à
la riposte froide et calculée. Avec Lady Vengeance, les représailles trouvent
un entre-deux que la conclusion
dépasse.
Pour
contrer la rudesse de cette violence immanente, Park emploie depuis l’origine
de longues séquences oniriques qui viennent sublimer les séquences de réalisme
plus crues. Qu’il s’agisse de rêves doux (assez rares), d’expériences sensorielles irréelles ou de fantasmes
voraces (tel Lee Geum-ja trimbalant
son persécuteur dans la neige), l’onirisme est partie prenante de l’évolution
du récit. Il permet à la fois de contrebalancer le rythme de l’intrigue et
d’apporter des espaces libératoires pour la tension. Cet onirisme se retrouve
par exemple dans la version director’s cut de Lady Vengeance. Park Chan-wook y
fait le choix de tourner les dernières scènes en noir et blanc, partant de
couleurs vives à des couleurs plus ternes au fur et à mesure que Lee Geum-ja se
rapproche de sa vengeance. Lorsque les parents se retrouvent après leur
vengeance, les seules couleurs présentes sont celles de leurs porte-clefs,
souvenir de leurs enfants perdus, comme un reste de vie qui les accompagnera
par la suite. L’onirisme est ainsi une manière pour Park Chan-wook de se
répandre dans des mises en scènes flamboyantes où chaque élément prend une
dimension particulière.
Le
dégoût de la vengeance et de la violence est nuancé tout au long de Lady
Vengeance de deux façons. D’un côté, les couleurs chatoyantes, une imagerie
iconique parfois kitsch, viennent
adoucir le début du récit avant que la transformation du personnage, ses
hésitations, son humanité affleurant s’affichent de façon plus sereine dans
l’image, avec moins d’effets visuels pour laisser davantage de place aux
protagonistes.
En
concluant sa trilogie avec Lady Vengeance, Park Chan-wook choisit consciemment
de donner à sa réflexion sur la vengeance une touche plus humaniste, plus
positive que dans les précédentes œuvres, signe d’une évolution et d’une
maturité. A chaque lecture, Lady Vengeance se dérobe pour mieux se dévoiler,
témoignage d’une vraie passion pour le cinéma, ample et intimiste.